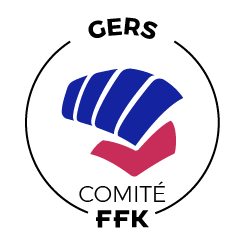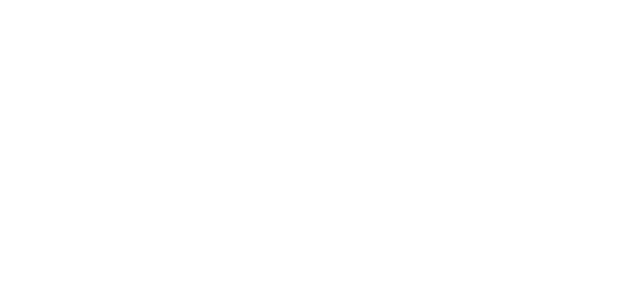Technicien hors pair, expert 8e dan, Jean-François Tisseyre revient sur les tatamis après « un accident de la vie » comme il le dit avec pudeur. Une épreuve qu’il analyse avec beaucoup de sensibilité, donnant à réfléchir sur ce que doit être la posture juste du combattant. Mots passionnants d’un homme d’envergure qui aime la discrétion.
Notre époque parle beaucoup de résilience et d’épanouissement personnel. Et vous, qu’en diriez-vous ?
Que c’est devenu du vocabulaire au service du marketing alors que c’est exactement ce que nous proposent historiquement les arts martiaux, les Budo, dans la construction de soi. Je laisse à d’autres le grand business de l’épanouissement personnel et même ses critiques, même si nous avons sans doute une part de responsabilité pour s’être tous laissé un peu déposséder de ça. Alors qu’en fait, tout est là. La culture a parfois été oubliée dans nos disciplines. Or, c’est ce qui compte. C’est le Do japonais, le Tao chinois, c’est-à-dire le chemin que nous devons emprunter, mais même plus que ça, la loi qui doit régir notre vie. Le reste peut se discuter : les styles, les écoles, la technique, tout ça, on peut toujours avoir une opinion et des sensibilités particulières, mais la loi ne peut pas se discuter. Elle est universelle : c’est la dignité qu’il faut montrer au cours d’une vie. Elle résonne un peu plus peut-être chez les gens aujourd’hui, puisqu’on parle d’Ikigai*, de mindfulness… Mais ce qu’il faut, ce qui est nécessaire et ce que nous pouvons proposer dans nos dojos de karaté et au-dehors en tant que pratiquant, c’est l’incarnation de cette posture digne.
*Le chemin qui fait sens pour les Japonais (de « ikiru », « vivre », et « kai », la « réalisation »).
Comment ?
Elle ne doit pas être une simple récitation. La posture juste dans la pratique, chacun est capable d’en saisir la vibration. Cela commence par réprimer ses peurs, s’écouter, écouter les autres, s’ouvrir pour ressentir. Dans mon enseignement, dans la transmission, qui sont vraiment deux grandes responsabilités, qui pèsent parfois je dois le dire, j’essaie vraiment de faire toucher cela du doigt, de faire comprendre, en tant qu’être humain et avec la chance d’une pratique martiale, le pouvoir que l’on a sur soi-même. Faire des gestes, c’est une chose, mais faire des gestes qui ont un sens, c’est autre chose, c’est le sens du Budo.
Comment s’ouvrir davantage justement, et enrichir cette pratique ?
D’abord ne plus penser en termes de cases comme la société nous le propose au quotidien. On fait du karaté, on fait du karaté traditionnel, on fait du karaté sportif, on fait du karaté pour la santé… mais le karaté, je devrais dire le Budo, c’est tout ça en même temps. Cela doit nous ramener à l’idée que la pratique, c’est d’abord de l’unité et pas de l’opposition, ce qui rejoint le concept vraiment très puissant d’Ikigai, venu du Japon, qui est en train de se diffuser dans la société, notamment avec des ouvrages grand public dans un contexte, post covid, où l’on prend un peu plus soin de soi, physiquement, mais aussi sur les plans émotionnel et spirituel.
Cela doit s’incarner…
D’abord, la façon de le dire est importante, parce qu’on peut le dire de façon superficielle, comme une récitation, ou que ça sorte du vécu. Et là, tout est différent. J’ai été victime de cet AVC il y a un peu plus d’un an, c’est arrivé au lendemain d’un stage où j’étais en super forme, comme ça, d’un coup. Je me suis retrouvé en chaise roulante, je me suis regardé la tronche de travers (sic), et j’ai rigolé. Par le rire et par l’humour, il y a beaucoup de choses qui arrivent à se résoudre. J’ai eu du temps, alors je me suis intéressé au zen, j’ai acheté un zafu (un coussin de méditation, NDLR) et, dans ma chambre d’hôpital, pendant huit mois, je faisais du zen. Un accident de la vie comme on dit auquel je n’avais jamais réfléchi. Mais j’ai compris qu’il fallait oublier le passé, être dans l’instant présent et avancer. Désormais, je fais zazen (méditation et posture assise) tous les jours à six heures du matin.
Diriez-vous que votre approche de la vie a changé ?
Je me suis toujours intéressé à l’esprit des arts martiaux, plus qu’au côté uniquement technique. On parle d’interne, d’externe… L’interne, finalement, c’est la prise de conscience de soi, du fonctionnement du corps, parce que l’on a tendance à oublier comment on fonctionne : de façon mécanique, anatomique, organique, mais aussi chimique. L’adrénaline de la confrontation, les endorphines qui nous rendent heureux et nous déstressent en pratiquant, la dopamine qui est l’hormone du plaisir et du bien-être,
et le zen qui active la glande pinéale, située au-dessus du cervelet et qui sécrète de la mélatonine, laquelle aide à réguler notre rythme biologique et notre sommeil… Tout cela n’est pas si complexe, et reste très intéressant à comprendre. J’ai eu le temps d’en prendre conscience à l’hôpital et j’ai essayé de le mettre à profit. Je me suis aussi intéressé à la quantique, l’infini grand et l’infiniment petit. Cela m’a aidé, une sorte de petit satori, d’éveil spirituel.
Y a-t-il une forme de renoncement à ce que vous étiez ?
Je ne suis pas obsédé par la pratique que je fais. Je fais mon « truc », tranquille, je ne me pose pas de question, je fais ce que je peux faire au quotidien avec ce que mon corps me permet et j’essaie surtout d’intégrer d’autres choses, au niveau de la conscience corporelle. Notre vie intérieure, finalement, est notre vie la plus concrète, une forme de deuxième vie. Mais comment le dire ? Cet accident, quelque part, m’a illuminé l’âme. Finalement, ce que j’étais avant, ça ne m’intéresse pas. C’est trop bas de niveau.
Peut-on dire que vous vous êtes découvert ?
Oui, et que j’ai appris à me connaître un peu mieux. Du coup, j’ai aussi regardé les vieux maîtres d’arts martiaux avec un regard différent. Gichin Funakoshi n’était peut-être pas un grand technicien, mais c’était un érudit. Morihei Ueshiba, fondateur de l’aïkido, et Kyuzo Mifune, l’un des disciples les plus brillants de Jigoro Kano, le fondateur du judo, avaient un concept singulier de l’univers, avec des connaissances profondes, anciennes, ce qui est différent du savoir que nous transmettons. Pour acquérir des connaissances, il faut aller les chercher, il faut creuser. J’ai mieux compris cela, je pense. Et puis, si le corps a ses limites, la force de l’esprit, c’est qu’il n’en a pas. Si j’avais su tout cela il y a quarante ans…
Qu’est-ce que cela aurait changé dans votre approche du combat ?
Le rapport à l’autre, celui entre deux individus qui combattent, c’est sûr. J’aurais travaillé sur l’importance du regard et sur la sensibilité. J’élève des chevaux, et je vois bien qu’ils perçoivent tout. L’écoute, l’odorat, la sensibilité du toucher, la vue, tout est beaucoup plus important chez l’animal, quel qu’il soit, du plus petit au plus grand. Nous, on regarde toujours le plus gros, le plus grand ou le plus important, alors que c’est le plus petit qu’il faudrait regarder.
Comment envisagez-vous de transmettre cette prise de conscience, ce message ?
J’ai intégré tous ces concepts à mes cours, aux stages qui reprennent doucement. Je les explique, je donne une lecture et je les matérialise, dans la posture, sur l’axe, sur le mouvement ondulatoire… Il ne faut pas que tout cela soit ésotérique pour les gens en termes d’approche. Il faut créer une vibration et c’est ce que j’essaie de proposer désormais, c’est ce que j’ai à donner de plus important je crois, et cela fait de moi un professeur considérablement plus riche. Après, pour que ce soit audible, il faut qu’il existe une ouverture chez les pratiquants, ou bien il faut la créer. Comment y parvenir ? Cela passe d’abord par un positionnement, par une attitude, celle de tout vouloir prendre pour qu’il vous reste un peu.
Un mot pour conclure, vous qui suivez le karaté dans son ensemble ?
Tu tombes, tu te relèves… Mais c’est la façon de se relever qui est importante. Si tu commences à te relever en traînant, ce n’est pas bon. Tu te relèves, droit, digne, élégant, en posture, le monde s’ouvre. C’est ce qui compte, quel que soit notre niveau. Y compris à haut niveau. Se remettre sur ses deux jambes d’un gros tampon, c’est ça, la posture.
« Notre vie intérieure, finalement, est notre vie la plus concrète, une forme de deuxième vie »